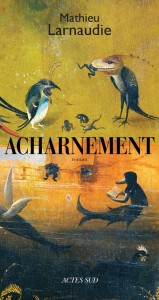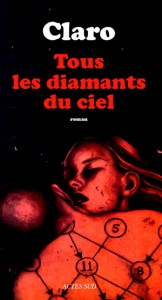 La conscience est effort, se réveiller labeur, et les modes d’évasion sont, il le sait, plus chiches que les ressources d’un prisonnier.
La conscience est effort, se réveiller labeur, et les modes d’évasion sont, il le sait, plus chiches que les ressources d’un prisonnier.
Un jour d’août 1951, Pont-Saint-Esprit, commune du Gard, se réveille dans le délire. Des habitants cherchent à se défenestrer, d’autres sont pris de convulsions, de vomissements. Environ 300 personnes sont concernées, dont sept décéderont, les autres étant affectées de troubles plus ou moins durables. Cela sans qu’aucune explication certaine n’en soit donnée. D’abord fut évoquée une intoxication liée à l’ergot de seigle ayant servi à la fabrication du pain spiripontain. D’où l’appelation qui fit grand bruit : l’affaire du pain maudit. Puis ce fut au tour d’un champignon d’être incriminé. Dernièrement, certains éléments orienteraient vers une intoxication au LSD. Celle-ci ayant été organisée par la CIA, dans le but de tester les effets de la molécule sur une population étendue. Moins farfelue que difficilement étayable, l’hypothèse est en tout cas à remettre dans le contexte de cette époque du péril rouge. Où l’on n’hésite pas à tester à grande échelle sur des populations militaires ou civiles, par exemple, les effets de la radioactivité.
Oui, et le seul fait que la chose fût envisageable suffisait à la rendre réelle, quand bien même indémontrable, comme si l’acceptation du monstrueux allait de pair avec la capitulation de la conscience.
Et c’est cet espace de l’envisageable, du possible qu’investit Claro avec les personnages d’Antoine, jeune boulanger de Pont-Saint-Esprit à l’époque des faits, de Lucy, ex-junkie américaine reconvertie dans le sex-shop et l’espionnage, et de Wen Kroy, espion au service de la CIA. Cet espace où tout n’est jamais exactement ce qu’il paraît être. Où tout n’est jamais ce qu’il est.
Tout est toujours tout autre chose
Le sexe est ce que l’on vend sous le couvert finalement pudibond de l’amusement industriel. On en oublie que la sexualité peut aussi et surtout se révéler véritable machine poétique et subversive. Comme sous la plume d’un Guyotat ou d’un Sade. La drogue peut certes être destinée à contrarier le péril rouge et devenir un joyeux bonbon libertaire, une virulente friandise. Mais elle est aussi ce fantastique ouvroir de réalité, cet outil de « connaissance par les gouffres » d’un Michaux. Dans le jouissif jeu de dupes, de chausse-trappes, de son roman, Claro décode brillamment les « évidences » de notre temps et ce qu’être manipulé veut dire.
Antoine finit par ouvrir les yeux, las d’être à son insu et depuis si longtemps le sourd magicien de lui-même.
On ne se révèle jamais être aussi bien manipulé que par soi-même. En bon apprenti de sa propre manipulation. Dans « Les diamants du ciel » se découvre, tout du long, et dans la surprise finale, ce qu’être lecteur veut dire. Que lire est moins être manipulé que se manipuler soi-même. Qu’on est acteur aussi de ses délires. Se découvre qu’il est dans la fonction de la littérature de troubler, désordonner, subvertir, abimer, s’abîmer.
Langage souvent dérange.
Claro, Tous les diamants du ciel, 2012 (à paraître le 23 août 2012), Actes Sud.