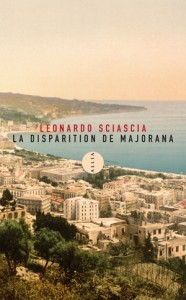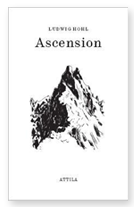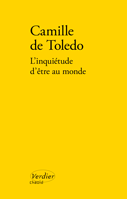Où un faussaire coiffé d’une postiche remet des faux billets à celui qu’il croit être son fils. Où ce même fils, dramaturge plagiaire à son corps défendant, croit avoir affaire à son père. Où un homme dédicace des ouvrages à tour de bras, et notamment des Tolstoï. Où un peintre de génie prête son talent pour réaliser des Bouts ou des Van Eyck. Où ce même peintre en perd son nom, jusqu’à en retrouver un autre lui cédé par un fournisseur de momies égyptiennes. Où les momies sont fabriquées à partir de bandelettes enfouies sous terre et arrosées quelques jours, et d’une jeune fille morte peu avant. Où même le pilier de bar est un faux Hemingway… « Les reconnaissances » se présente d’abord comme un catalogue jouissif de toutes les falsifications possibles. Et dans ce monde du semblant, Stanley, le musicien, Otto, le dramaturge, et Wyatt, le peintre, tentent chacun à leur manière (plus ou moins radicale ou accomodante) de résister à cette lame de fond du toc, à « ce diable (…), père du faux art ».
Où un faussaire coiffé d’une postiche remet des faux billets à celui qu’il croit être son fils. Où ce même fils, dramaturge plagiaire à son corps défendant, croit avoir affaire à son père. Où un homme dédicace des ouvrages à tour de bras, et notamment des Tolstoï. Où un peintre de génie prête son talent pour réaliser des Bouts ou des Van Eyck. Où ce même peintre en perd son nom, jusqu’à en retrouver un autre lui cédé par un fournisseur de momies égyptiennes. Où les momies sont fabriquées à partir de bandelettes enfouies sous terre et arrosées quelques jours, et d’une jeune fille morte peu avant. Où même le pilier de bar est un faux Hemingway… « Les reconnaissances » se présente d’abord comme un catalogue jouissif de toutes les falsifications possibles. Et dans ce monde du semblant, Stanley, le musicien, Otto, le dramaturge, et Wyatt, le peintre, tentent chacun à leur manière (plus ou moins radicale ou accomodante) de résister à cette lame de fond du toc, à « ce diable (…), père du faux art ».
Dans son premier chef-d’oeuvre (quatre suivront), William Gaddis s’ingénie à déconstruire le monde qui nous entoure en nous renvoyant son image dans la subtilité de chaque reflet. La surface de sa prose est telle ce miroir dans lequel les personnages cherchent assidument une preuve d’eux-mêmes. Miroir, c’est-à-dire le verre équipé de tain. Mais aussi une vitre, son reflet dans le regard de l’autre, le fait d’être nommé, la trace que laisse la main qui signe… Bref, tout ce qui peut rattacher chaque être à la conscience de sa réalité.
Ce… cet unique dilemme, prouver sa propre existence… Les gens ne reculeront devant aucune ruse pour ça…
La ruse que s’est trouvée l’époque contemporaine (et qu’elle croit ultime) est la possession. L’avoir laisse sa trace illusoire mais rassurante sur l’être. Et cette trace, son emblême par excellence c’est l’argent. L’argent, s’il n’a pas d’odeur, n’a pas non plus de valeur. Il est la valeur. Il est la construction technique d’une transcendance. Dieu s’efface et l’argent s’affirme. Il est l’aune à partir duquel tout est jugé. Alors que l’art est copié, le plagiat institutionnalisé, l’identité échangée, la paternité incertaine, le pire blasphème est de copier des billets de banque. L’hérétique, l’iconoclaste du 20 ème siècle est le faussaire de billets.
Nous vivons au sein de cet inventaire du faux. Mais Gaddis ne s’arrête pas à cette surface. Derrière le vernis de la satyre, il creuse le bois du réel.
Non, c’est… les reconnaissances vont beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin en arrière, et je… ces tests au rayons X et ultraviolets et infrarouges, les experts avec leur photomicographie, croyez-vous qu’il n’y ait que ça? Il y en a qui ne sont pas fous, ils ne cherchent pas un chapeau ou une barbe, ou un style qu’ils puissent reconnaître, ils regardent avec des mémoires qui… vont plus loin qu’eux-mêmes
Suprême ironie, notre époque, qui pousse jusqu’à son paroxysme cette logique du faux, est elle-même l’héritage du semblant. Ainsi, là où s’érigent aujourd’hui les églises d’un dieu peu à peu abandonné, célébrait-on autrefois le culte de Mithra, dans la pratique duquel était sacrifié un taureau, chaque 25 décembre. Mais cela n’est pas le résultat d’un lent glissement naturel. Rien de darwinien ici. L’évolution est faite de ruptures, de choix conscients (politiques, pragmatiques) où l’on présente la copie pour le vrai. Nous sommes englués dans le faux. Il nous constitue même.
La création véritable n’est dès lors possible sans la saisie de ce constat. Tout est fragmenté, le vrai et le faux s’entremêlant. L’art authentique n’est accessible que s’il se reconnaît héritier des palimpsestes qui le précèdent, l’auteur s’effaçant dans son oeuvre.
Gaddis, en compositeur de génie, réalise ce programme avec une rigueur et une ampleur inégalée. Et, pour notre plus grand bonheur, c’est le lecteur qui doit s’en faire l’interprète.
William Gaddis, Les reconnaissances, 1973, Gallimard.