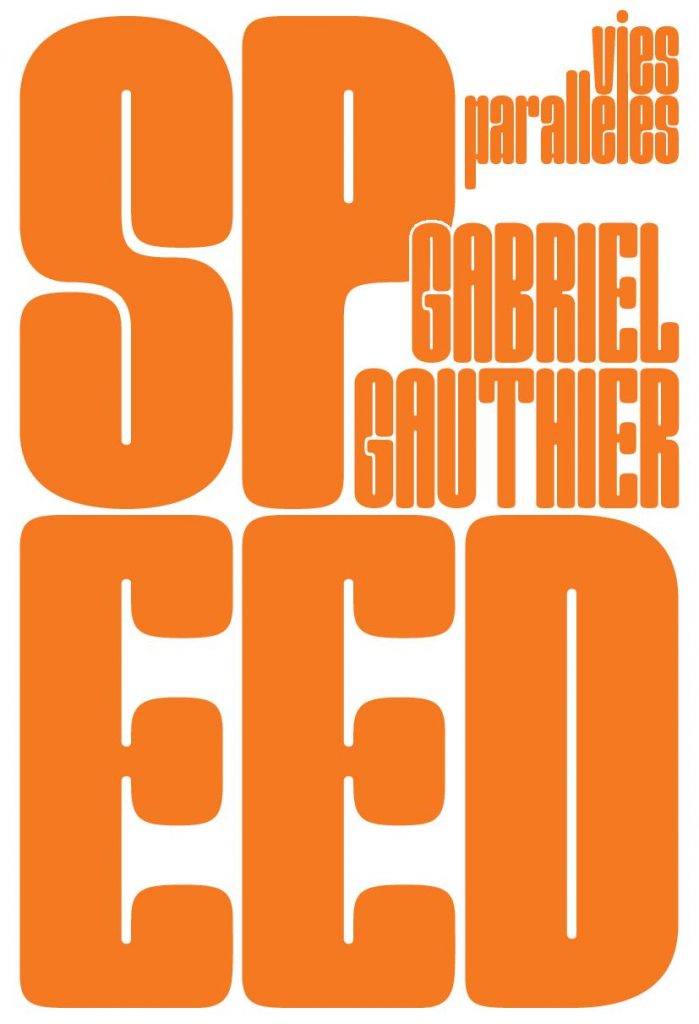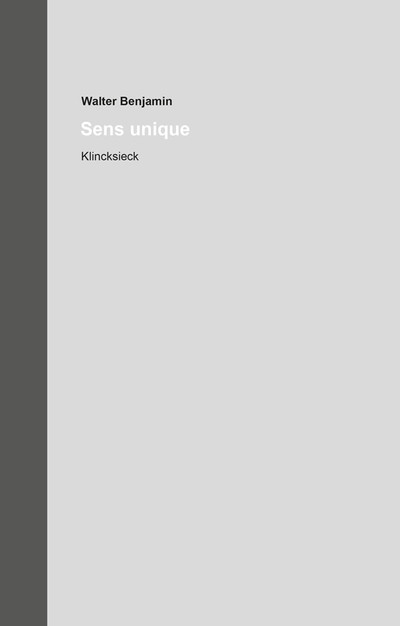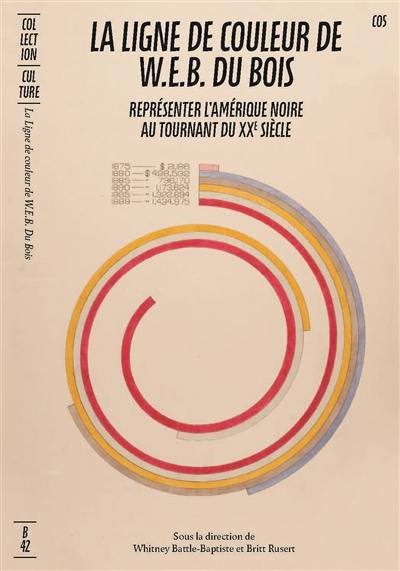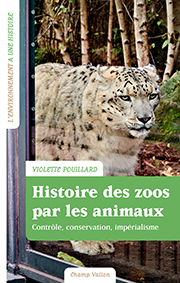Dévoiler, tout le problème est là : ni le chou ni l’éclair ne délivrent facilement leur contenu au cours d’une bataille, seulement quand on y mord, dans un décor de salon de thé ; pour ce qui est de s’épanouir sur le visage d’un figurant, c’est un échec couru d’avance, le chou rebondit, on dirait la mauvaise représentation d’un caillou du paléolithique en carton-pâte. Le génie simple de la tarte à la crème, déjà exposé dans son nom (tarte à la crème, comme on dirait pain à la mie) est de s’avancer sans mentir, ni retenir, et sans dissimuler, de laisser la crème à l’air libre au risque de la pluie et du vent, de s’afficher d’emblée, la gourmandise et la menace, latente, potentielle, à disposition, lunaire et solaire à la fois, en attendant de s’accomplir après un petit vol : sur un visage, de plein fouet, la tarte connaît l’avènement de son être et sa fin – sa fin de brave.
En 1927, Clyde Bruckman mettait en scène La Bataille du siècle dans lequel Stan Laurel jouait le rôle d’un boxeur professionnel et Oliver Hardy celui de son manager. Si la première partie du film ne devait pas laisser de grands souvenirs dans l’histoire du cinéma, la seconde en revanche est devenue iconique. À coups de 3000 tartes à la crème, Laurel et Hardy et les innombrables figurants ont construit un véritable monument burlesque à la pâtisserie.
On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens.
On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens : c’est bien cette phrase prononcée par Stan Laurel, le réalisateur, lors d’une interview, qui intéresse Pierre Senges. Une chose peut-elle être ce qu’elle est, tout simplement, ou doit-elle représenter autre chose qui la déborderait ou vers laquelle elle indiquerait et de laquelle alors la chose dépendrait? Y a-t-il un sens derrière chaque chose et le rôle d’un spectateur, d’un lecteur, est-il alors de l’y débusquer? Si chaque tarte n’est plus seulement un conglomérat d’œufs et de sucre mais bien, ainsi que le geste qui la lance et le visage qui la reçoit, le signifiant d’autre chose, cette bataille du siècle serait ainsi une débauche de sens… Et si l’on sait que derrière le rire, se loge du sens, le rire a-t-il encore un sens? Hein?
Une fois installés, les assignateurs de signification semblent être là depuis toujours et pour longtemps
En utilisant la forme fragmentaire qui lui est chère (et qu’il sait si bien rendre hilarante), Pierre Senges interroge notre propension actuelle à faire tout disparaître sous des couches et des couches de sens. À refuser qu’une chose soit ce qu’elle est et rien d’autre, que derrière la volonté de rire ou de faire rire ne puisse se dissimuler rien d’autre que la volonté de rire ou de faire rire. Et ainsi, en explorant les tours et détours que l’esprit humain s’ingénie à emprunter pour fuir la peur du non-sens universel, il réactive la force du grotesque. En dévoilant, par le récit de sa surenchère, le non-sens de la recherche éperdue du sens, Pierre Senges nous rappelle que c’est sans doute dans l’acceptation du non-sens universel lui-même que réside la possibilité d’y vivre et d’en rire. La tarte, lestée de signification, vole décidément moins bien. Mais, grâce à Pierre Senges, ce n’en est pas moins drôle…
Pierre Senges, Projectiles au sens propre, 2020, Verticales.