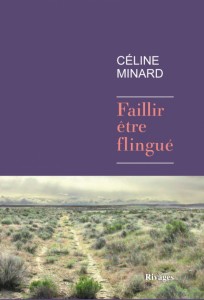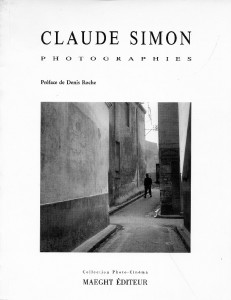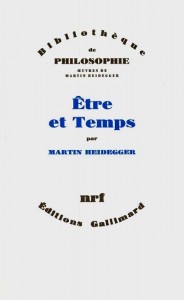 Ne subsiste bien souvent de certains livres, dans nos esprits assommés par la « nouveauté » , qu’une vague idée, que le souvenir lointain (et bien souvent déformé) de commentaires. N’en surnage que l’impression d’un déjà connu, d’un déjà lu, qui les fait irrémédiablement verser dans les limbes de ce qui n’est définitivement plus à lire. D’où l’idée de cette série de chroniques de retours aux textes lus. Sans commentaires.
Ne subsiste bien souvent de certains livres, dans nos esprits assommés par la « nouveauté » , qu’une vague idée, que le souvenir lointain (et bien souvent déformé) de commentaires. N’en surnage que l’impression d’un déjà connu, d’un déjà lu, qui les fait irrémédiablement verser dans les limbes de ce qui n’est définitivement plus à lire. D’où l’idée de cette série de chroniques de retours aux textes lus. Sans commentaires.
La question de l’être est aujourd’hui tombée dans l’oubli.
Cependant la « substance » de l’homme n’est pas l’esprit en tant que la synthèse d’âme et de corps, mais bien « l’existence ».
Avec la « T.S.F. », par exemple, le Dasein est en train d’opérer un dé-loignement du « monde » dont on ne peut encore embrasser du regard le sens qu’il aura pour le Dasein mais qui prend le chemin d’un élargissement désintégrateur du monde ambiant quotidien.
comme le « on » fournit d’avance tout jugement et toute décision, il ne laisse plus aucune responsabilité au Dasein. Le « on » peut, pour ainsi dire, se permettre qu’ « on » ait recours à lui constamment.[…] Et comme le « on » se porte constamment au-devant de chaque Dasein en le dispensant d’être, il maintient et accentue son opiniâtre domination.
Pour pouvoir se taire, le Dasein doit avoir quelque chose à dire, il doit disposer d’une véritable et riche ouvertude de lui-même. Alors éclate le silence-gardé et il cloue le bec au « on-dit ».
Assurément ce n’est qu’aussi longtemps que le Dasein, donc la possibilité ontique d’une entente de l’être, « est » qu’ « il y a » être. Si le Dasein n’existe pas, alors il n’ « est » pas non plus d’ « indépendance » et il n’ « est » pas non plus d’ « en soi ».
C’est en définitive l’affaire de la philosophie d’empêcher que « la force des mots les plus élémentaires » où s’exprime le Dasein, ne soit aplatie par le sens commun jusqu’à une inintelligence qui, à son tour, va fonctionner comme une source de faux problèmes.
Etre il n’ « y a » que dans la mesure où la vérité est. Et elle « est » seulement dans la mesure où et aussi longtemps que (un) Dasein est. Etre et vérité « sont » cooriginaux.
Le parti-d’y-voir-clair-en-conscience déterminé comme être vers la mort n’annonce pas non plus une retraite pour fuir le monde, mais pousse, au contraire, en dissipant toute illusion, à la résolution d’ « agir ».
la substance de l’homme est l’existence.
La vérité, entendue au sens le plus original, appartient à la constitution fondamentale du Dasein.
Pour pouvoir se mettre « pour de bon » à l’ouvrage au point de se « perdre » au milieu du monde des utils et pouvoir exercer son activité, le soi-même doit s’oublier.
La transcendance ne consiste pas dans l’objectivation ; c’est celle-ci qui présuppose celle-là.
Le lendemain dans l’attente duquel demeure la préoccupation quotidienne, c’est l’ « éternel hier ».
Et puisque finalement le sens de être en général passe pour aller, sans question, de soi, la question du genre d’être du monde-historial et du mouvement de l’aventure en général passe pour être « au fond » stérile – l’art de compliquer ce qui est simple en chicanant sur les mots.
« Se » perdant dans une foule d’occupations, celui qui n’est pas résolu « perd son temps » au milieu d’elle.
Le on, qui ne meurt jamais et mésentend l’être vers la fin, donne cependant de la fuite devant la mort une explicitation caractéristique. D’ici à la fin « il a toujours encore du temps ». […] « maintenant juste encore cela, ensuite cela, et seulement encore cela et ensuite… ». Ici la finitude du temps ne risque pas d’être entendue ; au contraire devant ce temps, qui va encore et « continue d’aller », la préoccupation n’a d’autre but que d’en rafler le plus possible.[…] On ne connaît que le temps officiel qui, nivelé comme il est, est à tout le monde et n’est donc à personne.
Martin Heidegger, Etre et Temps, 1986, Gallimard.