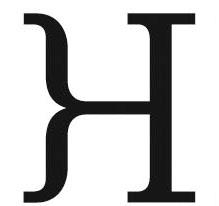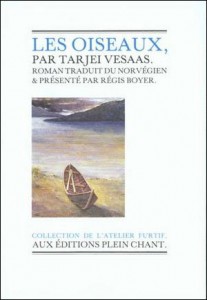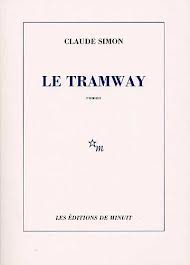 Et de nouveau cela s’est produit.
Et de nouveau cela s’est produit.
Le narrateur se souvient du tramway qui le ramenait de l’école à la demeure que sa mère louait sur la Côte d’Azur quand une douleur l’extirpe à son flot des souvenirs et le ramène au lit d’hôpital où il gît en transit.
Alors qu’il est entouré de tout ce qui le ramène à sa finitude inexorable, tel ce vieillard du lit d’à côté, envisageant chacun de ses gestes avec l’économie absurdement prudente du dernier souffle ;
Ce misérable acharnement qu’il mettait non seulement à vivre mais à nier une déchéance qu’il incarnait jusqu’à un insupportable degré d’indécence.
Alors que comme tout malade, il s’ingénie à concentrer sa mémoire sur ce qui pourrait l’éloigner de cette expérience de sa mort, [sa] vie de malade tout entière concentrée sur une multitude de ces infimes détails, tout comme son voisin figurant d’autant mieux la mort qu’il cherche à la tromper, le narrateur n’exhume du passé que des images qui le ramènent à sa condition mortelle. Le brancard le ramène au tramway, qui le ramène à sa mère mourante, qui le ramène aux homme-troncs, ces stigmates montés sur roues de 14-18, qui le ramènent aux châsses portées à dos d’homme, qui le ramènent à Charon… Et l’image qui peu à peu émerge est celle de la servante, massacreuse de rats et de chatons, qui veilla jusqu’à son terme, en Erinye consciencieuse, la mère du narrateur jusqu’au bout.
Comme si entre l’animal survivant de la préhistoire et la femme qui portait sur elle cet impénétrable visage de cuir desséché, avec la même sauvage tendresse que lorsqu’elle s’occupait de maman, existait une sorte de pacte ou de lien occulte, de silencieuse connivence, comme on ne savait quelle alliance scellée du fond des âges, plus forte que le temps et la mort.
C’est cela qu’est Le tramway. Un exercice de mémoire. Ou plutôt, Proust hantant ce livre-ci de Simon plus encore que les autres, une recherche du temps. Où la mémoire, telle une vague (pouvant en même temps sentir au-dessus de moi cette chose puissante qui soulevait avec douceur la grosse barque puis l’accueillait mollement comme dans un berceau liquide puis montait de nouveau) fait affleurer sur la page en les mêlant passé et présent. Au creux de cet impalpable et protecteur brouillard de la mémoire, le temps se retrouve tout entier comme en des points de saisie, sur un visage, un objet, rompant avec l’idée du temps-continuum.
Comme si rien – ou presque – n’avait changé.
Claude Simon, Le Tramway, 2001, Minuit.