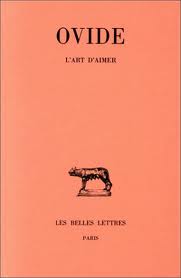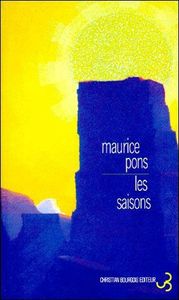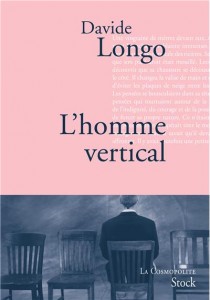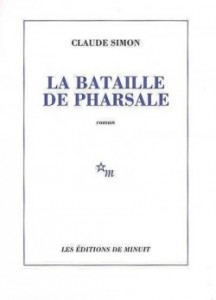Ne subsiste bien souvent de certains livres, dans nos esprits assommés par la « nouveauté » , qu’une vague idée, que le souvenir lointain (et bien souvent déformé) de commentaires. N’en surnage que l’impression d’un déjà connu, d’un déjà lu, qui les fait irrémédiablement verser dans les limbes de ce qui n’est définitivement plus à lire. D’où l’idée de cette série de chroniques de retours aux textes lus. Sans commentaires.
Ne subsiste bien souvent de certains livres, dans nos esprits assommés par la « nouveauté » , qu’une vague idée, que le souvenir lointain (et bien souvent déformé) de commentaires. N’en surnage que l’impression d’un déjà connu, d’un déjà lu, qui les fait irrémédiablement verser dans les limbes de ce qui n’est définitivement plus à lire. D’où l’idée de cette série de chroniques de retours aux textes lus. Sans commentaires.
Mars impie se déchaîne dans tout l’univers ; ainsi, quand ils se sont échappés de leurs loges, les quadriges prennent de la vitesse ; en vain le cocher raidit les guides ; ses chevaux l’emportent, et l’attelage n’obéit plus aux rênes.
Je n’entends pas tout embrasser dans mes vers, non, même si j’avais cent langues, cent bouches, une voix de fer.
et tant que le sarment s’élance avec joie dans les airs, lâché à toute bride dans l’espace pur, il ne faut pas encore attaquer la tige avec le tranchant de la serpe, mais de l’ongle, pincer le feuillage et l’éclaircir.
Fais l’éloge des vastes domaines, cultives-en un petit.
O trop heureux les cultivateurs, s’ils connaissaient leur bonheur! […] c’est là que la Justice, en quittant la terre, a laissé la trace de ses derniers pas.
Heureux qui a pu connaître les principes des choses, qui a foulé au pied toutes les craintes, l’inexorable destin et tout le bruit fait autour de l’insatiable Achéron! Bienheureux aussi celui qui connaît les dieux champêtres, et Pan, et le vieux Silvain et les Nymphes soeurs! Celui-là ne se laisse émouvoir ni par les faisceaux que donne le peuple, ni par la pourpre des rois, ni par la discorde qui met aux prises les frères sans foi, ni par le Dace qui descend de l’Ister conjuré, ni par les affaires de Rome et le sort des royaumes destinés à périr. Celui-là ne voit ni pauvre à plaindre avec compassion ni riche à envier. Les fruits que portent les branches et ceux que donnent spontanément les campagnes bienveillantes, il les cueille, ignorant la rigueur du code, les démences du forum ou les archives nationales.
Qui ne connaît l’inflexible Eurysthée ou les autels de l’infâme Busiris?
Mais le temps fuit, fuit sans retour, tandis que, séduits par notre sujet, nous en faisons le tour, de point en point.
Mais un doux penchant m’entraîne à travers les escarpements déserts du Parnasse.
Virgile, Géorgiques, 30 av J.C, Les Belles lettres, trad. E. de Saint-Denis.