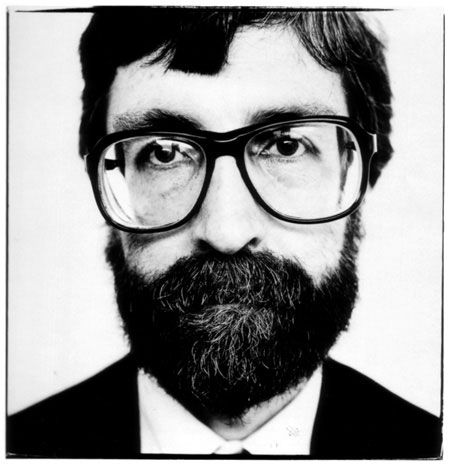Nous étonne depuis longtemps l’ombre à peu près complète dans laquelle sont laissées, dans le champ francophone et ce jusqu’aux sphères académiques, des pensées considérées partout ailleurs comme absolument déterminantes. Tout entier occupé à rabattre sur elles-mêmes ses certitudes tranquilles à coups de citations nietzschéennes ou deleuziennes, le lecteur francophone prétendument averti méconnait souvent avec paresse et componction des pans gigantesques de ce qui se fabrique au-delà de ses très étroites frontières épistémiques. Faisant la moue à la seule mention d’ « analytique », de « logique », d’ « herméneutique » ou de « cognitif » et hanté par d’absurdes préjugés, il fabrique en vase clos des résistances sans plus très bien savoir à quoi il se dit résister. Ainsi enfermé dans une rengaine qui n’a de pensée que le nom, il manque d’apercevoir vraiment des textes importants quand il s’en dégage dans ses environs immédiats (Quentin Meillassoux) et consacre à leurs places des impostures manifestes (Bruno Latour). En donnant à lire quelques extraits d’œuvres unanimement considérées comme majeures, nous espérons inciter un peu plus le lecteur francophone à sortir de son fort douillet carcan. La pensée, après tout, n’est pas le confort…
Il peut être difficile d’accepter que le Mythe du Donné est un mythe. On peut avoir l’impression que rejeter le Donné, c’est nous rendre à nouveau vulnérable à la menace à laquelle l’idée de Donné est une réponse, la menace que notre conception ne permette aucune contrainte externe sur les activités de la pensée et du jugement empiriques. On peut avoir ici l’impression de réserver un rôle pour la spontanéité tout en refusant de reconnaître un quelconque rôle à la réceptivité. Et c’est inacceptable. Si nous voulons reconnaître aux activités de la pensée et du jugement empiriques une portée sur la réalité, nous devons trouver une contrainte externe. La réceptivité doit avoir un rôle, tout autant que la sensibilité. La sensibilité doit avoir un rôle, tout autant que l’entendement. En en prenant conscience, nous ressentons l’urgence de battre en retraite et d’en appeler au Donné. Tout cela pour nous rendre encore une fois compte que cela ne sert à rien. Nous risquons d’être pris au piège d’une perpétuelle oscillation. Il y a cependant bien un moyen de sauter de la balançoire.
Les pensées d’autrui peuvent bien sûr nous sembler au début opaques. Il peut être laborieux d’accéder aux contenus conceptuels qu’autrui engage dans sa relation avec le monde. Mais par ailleurs, nous avons de toute évidence ce monde sous les yeux. Je n’ai rien dit qui mette en doute ces évidences. L’idée que j’entends écarter est la suivante : quand nous cherchons à comprendre autrui, les relations sur lesquelles nous nous appuyons, entre le monde et le système de concepts (lequel a déjà été élaboré) qui permet à autrui de penser, sont déjà là; de sorte que lorsque nous jaugeons le contenu des capacités conceptuelles, au départ opaques, à l’œuvre au sein du système, nous remplissons les blancs d’une image gagnée à la marge (« à ma droite le système conceptuel, à ma gauche le monde ») qui n’a jamais cessé d’être disponible depuis le début, même si ce n’était d’abord qu’une esquisse. Croire qu’une telle idée rend compte adéquatement du travail d’interprétation nécessaire à la compréhension d’autrui, ou qu’une version de cette idée peut adéquatement rendre compte de la façon dont nous faisons, au cours d’une éducation ordinaire, l’acquisition d’une capacité à comprendre les autres locuteurs de notre langue, cela relève de l’illusion. Cette conception situe le monde au dehors d’une limite qui entoure le système que nous sommes supposé avoir appris à comprendre. Dans cette conception, nous ne pouvons rien reconnaître qui corresponde à la compréhension d’un ensemble de concepts doués d’une substance empirique. […] L’illusion est insidieuse : au point de provoquer une aspiration à comprendre notre propre pensée marginalement, lorsque nous pensons que telle est la condition de quelqu’un d’autre, quand il nous comprend. […] Si nous pouvons envisager le caractère spécifique de cette pensée, ce n’est pas en remplissant les blancs d’une image marginale préexistante et qui rendrait compte de la façon dont la pensée de cette personne porte sur le monde, mais c’est en partageant progressivement avec elle un point de vue au sein d’un système de concepts, un point de vue à partir duquel nous pouvons partager son attention, et ainsi la rejoindre dans sa visée du monde, sans qu’il soit nécessaire de forcer une brèche dans la limite qui entoure le système de concepts.
John McDowell, L’esprit et le monde, Vrin, trad. Christophe Alsaleh.
(Cet ouvrage, paru en 1998 aux USA, a exercé outre-Atlantique une immense influence sur les recherches philosophiques de ces dernières décennies. Au-delà de son « idée maîtresse » – idée géniale qui est, pour faire très très court, d’étendre la structure conceptuelle au domaine de l’expérience – il offre au lecteur l’exemple paradigmatique d’une pensée qui se bâtit aux antipodes des postures doctrinales. Wittgenstein, Kant, Gadamer, Hegel, Quine, Sellars, Rorty, Marx, etc. c’est bien en puisant avec avidité et rigueur dans tout ce qui peut éclairer une intuition, plutôt qu’en campant sur des présupposés idéologiques, qu’il est possible de construire à cette intuition un édifice intellectuel solide et novateur. On ajoutera encore que les implications « naturelles » de cet édifice ne sont pas sans conséquences quant à notre façon d’aborder nos relations aux animaux non humains…)