 En ce jour d’élection régionale française, telle la France rassemblée au chevet de ses valeurs, le jury ptyx s’est réuni en vue d’attribuer son prix annuel. Pour nous aussi, la tradition n’est pas un vain mot! Seul prix objectif remis par un seul sujet, ne donnant droit à rien, garanti sans bandeau et assumant pleinement le ridicule de sa fonction, le prix ptyx 2015 eût pu ceindre nombre de titres lus cette année. Mais, voilà, si, justement, le prix ptyx se distingue de tous les autres prix, il n’en est pas moins un prix et son jury se devait dès lors de sacrifier à ce qui fonde tout prix : distinguer. Raison pour laquelle, parmi l’immense masse de livres lus cette année, nous avons choisi, après un processus rigoureux et en totale conformité avec nos statuts, et en écartant (cela va de soi) les livres dont nous sommes également l’éditeur, nous avons choisi donc d’attribuer l’inutile sésame aux trois livres suivants (ben oui, trois…) :
En ce jour d’élection régionale française, telle la France rassemblée au chevet de ses valeurs, le jury ptyx s’est réuni en vue d’attribuer son prix annuel. Pour nous aussi, la tradition n’est pas un vain mot! Seul prix objectif remis par un seul sujet, ne donnant droit à rien, garanti sans bandeau et assumant pleinement le ridicule de sa fonction, le prix ptyx 2015 eût pu ceindre nombre de titres lus cette année. Mais, voilà, si, justement, le prix ptyx se distingue de tous les autres prix, il n’en est pas moins un prix et son jury se devait dès lors de sacrifier à ce qui fonde tout prix : distinguer. Raison pour laquelle, parmi l’immense masse de livres lus cette année, nous avons choisi, après un processus rigoureux et en totale conformité avec nos statuts, et en écartant (cela va de soi) les livres dont nous sommes également l’éditeur, nous avons choisi donc d’attribuer l’inutile sésame aux trois livres suivants (ben oui, trois…) :
« La Chambre peinte » de Inger Christensen.
Face à toute cette misère j’ai depuis toujours pensé qu’il était trop tard pour prendre la parole, au moment où Dieu et n’importe qui ne font (déjà) que parler et parler encore tandis que personne n’écoute.
Entre 1465 et 1474, Andrea Mantegna peignit à fresque la chambre des époux. Commandité par Ludovico III de Gonzague, seigneur de Mantoue, ce travail énorme devait symboliser la puissance de sa famille au sein même du Castello di San Giorgio, forteresse où la famille élit domicile après le concile de Mantoue. Représentant la famille en cour ou lors d’une rencontre sur fond d’une Rome idéalisée, ce joyau des arts est l’occasion, pour Inger Christensen, d’y ancrer un récit dont la plurivocité des voix en permet une « analyse » renouvelée tout en l’ouvrant vers un ailleurs subtil. L’occasion, aussi, d’en démontrer l’intemporalité.
et il va jusqu’au bout de la logique, là où la construction de cette logique s’effondre et s’émiette en illusions.
Le récit de Inger Christensen est construit en triptyque. Le premier narrateur est Marsilio Andreasi, secrétaire du marquis Ludovico et confident de Mantegna. Présenté comme amoureux de Nicolosia, qui épousa le peintre, son témoignage nous est ramené sous forme d’un journal s’étendant de l’an 1454 à 1506. Dans la deuxième partie, c’est Maria (ou Farfalla) qui est la narratrice. « Réceptrice des tous les secrets », elle nous conte l’histoire des liens qui tissent l’histoire complexe de la famille Gonzague, principalement autour du personnage de Nana, la fille naine de Ludovico. Enfin, dans la troisième partie, voix est donnée à Bernardino, le fils de dix ans de Andrea Mantegna. Trois narrateurs différents. Trois représentations – à des degrés divers – dans la fresque de la chambre des époux. Trois registres de discours différents (un journal donc un narrateur sans cesse en devenir, une femme contant des faits tous advenus donc une narratrice « omnisciente », un enfant de dix ans (mort à onze) contant à chaud un souvenir onirique de vacance). Trois portraits. Trois biais.
Si l’Etat peut être une oeuvre d’art […] l’oeuvre d’art peut être un Etat.
La chambre peinte déploie les questions de l’oeuvre de Mantegna en interrogeant les regards de ceux qui, peints a fresca, nous regardent par delà les temps et leurs apparences figées. Jamais analyse de l’oeuvre de Mantegna au sens strict, celle de Christensen y prend appui pour en enrichir les secrets plus que pour les dévoiler. Et parvient ainsi – miracle du procédé – à en dire mieux et plus que beaucoup d’études académiques. En articulant, mais renouvelés, les principes de la fresque mantouaise dans le corps du récit, sa logique, son symbolisme, Inger Christensen nous convie à un jeu. Jeu dont l’émotion, mieux que d’en n’être pas expurgée, en est un des principe. Et qui fait de cette Chambre peinte une essentielle et bouleversante chambre des mystères.
l’âme du portrait, qui est la leur, leur fait peur.
Inger Christensen, La chambre peinte, un récit de Mantoue, 2015, Le Bruit du Temps, trad. Karl & Janine Poulsen.
Les sons ci-dessus sont tirés de l’émission « Les glaneurs » sur Musique 3, présentée et produite par Fabrice Kada, réalisée par Katia Madaule. Nous étions accompagnés ce soir-là par l’excellent Laurent De Sutter et la parfaite Mathilde Maillard.
« L’infinie comedie » de David Foster Wallace
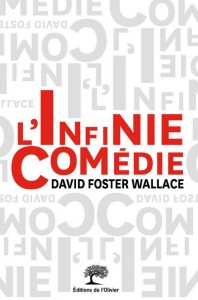 Il pensa très généralement aux désirs et aux idées que l’on contemple sans les mettre en pratique, il pensa aux pulsions qui, privées d’expression, sèchent et se dissipent sèches, songea que d’une certaine manière cela avait un rapport avec lui, avec les circonstances et avec ce qui, si cette éreintante ultime orgie à laquelle il se préparait ne résolvait pas le problème, devait être sûrement appelé son problème, mais il n’eut pas le temps de concevoir en quoi l’image de pulsions desséchées se dissipant par dessiccation se rapportait à lui ou à l’insecte, qui était rerentré dans le trou du support anguleux, parce que, à ce moment précis, son téléphone et le buzzer de l’interphone retentirent simultanément, si sonores, si cruels, si abrupts qu’ils percèrent un petit trou dans le grand ballon de silence coloré à l’intérieur duquel il attendait assis, et il alla d’abord vers la console téléphonique, puis vers le bouton de l’interphone, puis tenta plus ou moins d’aller vers les deux à la fois, si bien qu’il demeura planté, jambes écartées bras en croix comme si quelque chose avait été jeté, écrabouillé et enseveli entre les deux sonorités, la tête vide de toute pensée.
Il pensa très généralement aux désirs et aux idées que l’on contemple sans les mettre en pratique, il pensa aux pulsions qui, privées d’expression, sèchent et se dissipent sèches, songea que d’une certaine manière cela avait un rapport avec lui, avec les circonstances et avec ce qui, si cette éreintante ultime orgie à laquelle il se préparait ne résolvait pas le problème, devait être sûrement appelé son problème, mais il n’eut pas le temps de concevoir en quoi l’image de pulsions desséchées se dissipant par dessiccation se rapportait à lui ou à l’insecte, qui était rerentré dans le trou du support anguleux, parce que, à ce moment précis, son téléphone et le buzzer de l’interphone retentirent simultanément, si sonores, si cruels, si abrupts qu’ils percèrent un petit trou dans le grand ballon de silence coloré à l’intérieur duquel il attendait assis, et il alla d’abord vers la console téléphonique, puis vers le bouton de l’interphone, puis tenta plus ou moins d’aller vers les deux à la fois, si bien qu’il demeura planté, jambes écartées bras en croix comme si quelque chose avait été jeté, écrabouillé et enseveli entre les deux sonorités, la tête vide de toute pensée.
Debord pensait la société du spectacle advenue, déjà parfaitement réalisée. Oui, mais voilà, Debord n’avait pas lu Infinite Jest! Non seulement le chef d’oeuvre de Wallace n’avait pas encore été traduit (traduction qu’il a fallu attendre 17 longues années), mais pas même encore composé avant la mort du situationniste en 1994. Il avait donc deux solides excuses. S’il avait pu le lire, gageons qu’il eût revu son constat.
Comment faire pour ne pas être 130 personnes profondément seules qui vivent en promiscuité.
Dans ce roman fleuve de 1486 pages (écrit tout petit), nous suivons – entre tant d’autres – les destins de trois personnages principaux. Marathe est un A.F.R. (Assassin en Fauteuil Roulant), traître à sa nation, et engagé dans la quête d’une arme absolue ; Hal Incandenza est un jeune tennisman surdoué, fils d’un célèbre cinéaste, qui suit un enseignement spécialisé dans une école de tennis de Boston ; Don Gately est un ancien drogué au Démérol engagé comme employé-résident dans un centre de désintoxication. Le Mexique, le Canada et les U.S.A ont depuis longtemps fusionné au sein d’un ensemble dénommé O.N.A.N (sisi). Le Québec fait seul figure de sécessionniste. Un enjeu géostratégique majeur est l’appropriation de terrains destinés à accueillir les déchets de la super-nation. Tout le monde, à des degrés divers, est sous assuétude. Le culte de l’excellence et la sur-consommation sont devenus des normes incontestées. Le temps est sponsorisé (ainsi suivons nous ces personnages principalement lors de « l’année des sous-vêtements pour adultes incontinents Depend »). La télévision a été remplacée par le téléputeur, omniprésent moyen technique qui permet à chacun de regarder un choix infini de cartouches de divertissement. C’est dans ce contexte qu’est découverte une mystérieuse cartouche, réalisée par James Incandenza, le père de Hal, dont les effets (ceux de la cartouche) sont de plonger qui la regarde dans un état de dépendance absolu. Une fois visionnée, le seul objectif du spectateur se limiterait à la regarder encore, et encore, et encore. En niant tout le reste, jusqu’à ses propres besoins corporels. L’arme absolue…
C’est vous qui acceptez de vous laisser agréablement divertir. C’est bien un choix, non? Le droit sacré du spectateur, un choix libre, non? Oui?
Dans ce monde médicamenté, d’où tout transcendant est supprimé jusqu’à n’en avoir plus même laissé le pâle souvenir, c’est le choix seul qui, à force d’en être rabâché comme un de ses éléments essentiels, a pris la place de la liberté. Si être libre c’est avoir le choix et ne plus qu’avoir le choix, la liberté se réduit rapidement à choisir son assuétude. Jusqu’à ne plus pouvoir sen dépêtrer. Jusqu’à rechercher, en toute liberté, celle qui nous libérera – suprême et terrifiant paradoxe – d’avoir à choisir.
Votre choix se résume à ceci : le plaisir de ne pas choisir.
L’horreur sans nom du monde peint par D.F.Wallace ne tient pas à son étrangeté. Mais bien au rapport intime qu’il entretient avec le nôtre. Certes univers baroque dont l’exagération est érigée en paradigme – où les gens se suicident au micro-ondes ou au broyeur à ordures, où on ne se parle plus mais « interface », où brimer les enfants dès leur plus jeune âge est une technique éducative reconnue – ce monde nous paraît être le nôtre parfaitement réalisé, sa prolongation la plus démesurée, mais aussi sa plus naturelle.
Mais par delà cette redoutable – et peut-être propitiatoire – analyse d’un monde sans repère, c’est surtout à une extraordinaire et subtile comédie humaine que nous convie l’auteur culte. Entre rires de terreur émue et larmes d’ironie, cette infinie comédie n’est rien d’autre qu’une des expressions les plus troublantes de la solitude qui nous définit tous. L’insoutenable de la condition humaine et ses risibles – car vains, toujours vains – efforts pour s’en extirper ou s’en contenter.
Aucun instant n’est insupportable, pris séparément […]. Ce qui est insoutenable, c’est l’idée de tous ces instants mis bout à bout, tous ces scintillements qui s’étendent devant lui à la file.
L’infinie comédie est bien aussi ce jet continu, cette glose sans fin par laquelle un être humain entretient désespérément un fragile et illusoire contact avec un autre être humain. Un personnage avec un autre. Un auteur avec un lecteur.
Pour résumer ce dont nous parlons ici, c’est de solitude.
Vous êtes seul. Vous allez mourir. Voilà deux raisons suffisantes pour lire cet éreintant chef d’oeuvre…
David Foster Wallace, L’Infinie Comédie, 2015, L’Olivier, trad. Francis Kerline.
Les sons ci-dessus sont tirés de l’émission « Les glaneurs » sur Musique 3, présentée et produite par Fabrice Kada, réalisée par Katia Madaule. Nous étions accompagnés ce soir-là par The BD specialist Pierre de Jaeger et le remuant dramaturge Olivier Hespel.
« Jusqu’au cerveau personnel » & « [Nouure] » de Philippe Grand.
 Mon idéal-lecteur aime le sens et qu’on lui en complique l’accès. Il me ressemble : déteste qu’on le pense sans dents, bon qu’à téter.
Mon idéal-lecteur aime le sens et qu’on lui en complique l’accès. Il me ressemble : déteste qu’on le pense sans dents, bon qu’à téter.
On ne compte plus les œuvres n’ayant comme propos et finalité qu’elles mêmes. Parfois, n’ayant d’autre raison d’existence que celle de venir confirmer celle de qui l’a écrit, le nom encré sur la couverture semble se borner à ancrer l’ « auteur » dans le « réel » (à force de dire « je », ce « je » finira bien par advenir!). Parfois, le retour sur les modalités de son existence parait, comme sur commande, n’être qu’un effet de mode, comme garantissant le sérieux de l’ « auteur » (quel meilleur gage de sérieux donner dans un domaine que de faire montre de s’intéresser aux modalités de production essentielles de ce domaine). Soit onanisme scripturaire, soit entre soi pédant, l’ « œuvre égocentrique » échappe en fait bien difficilement aux affres de l’égo de qui l’écrit.
un écrit tout à dire d’où il vient et comment il avance.
Ici, le livre tout entier centré sur lui-même, l’est vraiment sur lui-même. Et non sur l’auteur. Il n’a d’autre projet que lui-même. Il n’est que sa propre fin, dont les moyens sont détaillés jusque dans leurs rouages les plus fins.
notes comme libérées de la musique
Libéré de ses contraintes (narration, rapport au réel, genre, espace de la page, etc…), accointant avec le Rien, le livre est ici une écriture de l’écriture. Mais qui ne profite pas de l’abandon des contraintes pour justifier une « facilité ». Ainsi de l’esthétique du fragment, qui souvent sert à dissimuler une impossibilité à construire, et qui, ici, est repensé dans les écarts qu’il peut présenter par rapport au « segment ». Livre-parties d’un livre plus vaste, auquel ils renvoient pour le creuser mieux, Jusqu’au cerveau personnel et [Nouure] fonctionnent comme des vrilles*.
Est-ce autre chose, l’âme, que ce que montre une phrase déchirée?
Creusant en vrillant dans un corps (du bois, du liège), la vrille ramène à la surface ce qui était enfoui dans la matière, mais l’élargi aussi et la fait déborder sur ce qui l’entoure. Ainsi fonctionne l’écriture de Philippe Grand qui, centrée jusqu’à l’obsession sur elle-même, creusant toujours plus avant, la précisant toujours mieux car différemment, en vient à éclairer bien plus large que son si étriqué sujet.
Un corps que la vie a quitté occupe moins de place qu’il n’en aurait occupé au terme de son développement dans des conditions normales : du temps a manqué à ce corps, mais en aucun cas, on ne regarde l’espace autour de l’enfant mort comme l’absence de corps.
Regarder le blanc d’une page comme une absence d’encre (ce blanc dont l’insupportable ne semble pouvoir être vaincu par l’auteur qu’une fois vérifiée sa capacité à le noircir), envisager le livre comme chapitre d’un livre dont il n’est que partie, penser le temps de l’édition d’un livre en rompant avec celui de son écriture, si tout cela, certes, renvoie directement à la question de l’écriture, il n’en éclaire pas moins des pans autres. Concentrant son faisceau (concentrer, c’est-à-dire focaliser, mais aussi aller à la moelle, à l’essence de la matière) sur son sujet, il le creuse, le précise toujours mieux. Mais, bien loin de ne renvoyer toujours plus qu’à elle-même, à se « spécialiser », l’écriture bien menée sur l’écriture va titiller, dans ses tréfonds, ce qui s’y loge d’universel.
Je n’écris pas mais sculpte.
Aventure poétique – et donc (n’en déplaise à ceux qui ne lisent Platon que via des formules) philosophique! – hors-norme, la tentative de Philippe Grand est assurément l’une des plus vertigineuses, inventives, et originales qu’il nous ait été donné de lire!
Ce qui éclot à bout de plénitude, la cible de toute sève, cette
couleur soutenue par un faisceau d’accomplissements, c’est Rien,
l’accord des choses à elles-mêmes, que je recueille pour éclairer
mes murs et résonner à leur hauteur.
Philippe Grand, Jusqu’au cerveau personnel, 2015, Héros-Limite.
Philippe Grand, [Nouure], 2015, Eric Pesty.
Les sons ci-dessus sont tirés de « Temps de Pause » sur Musique 3, émission orchestrée de main de maîtres par Fabrice Kada et Anne Mattheeuws.
*Et ces vrilles, pour gagner en vertige, sont ici éditées simultanément et sous (presque) les mêmes atours.


