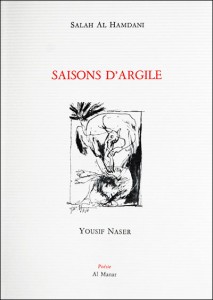Macias Möll, vieil horloger paralytique, partage son « temps » entre la réparation des montres et la préparation de sa chaise roulante en vue d’améliorer ses « temps » dans la descente de la petite place .
Macias Möll, vieil horloger paralytique, partage son « temps » entre la réparation des montres et la préparation de sa chaise roulante en vue d’améliorer ses « temps » dans la descente de la petite place .
Sa passion, il la vouait aux assemblages mécaniques, à cette ingénierie d’infimes calculs logée au coeur des montres, ainsi qu’au ciment lissé qui couvrait la pente de la petite place et lui permettait de la descendre avec précision. Les pentes étaient semblables aux heures. Temps et mouvement, deux paramètres immuables qu’il avait appris à maîtriser.
D’un côté, chercher à maîtriser les rouages qui rendent compte du temps. De l’autre affiner ceux qui permettront de l’amputer de quelques centièmes. Le temps, seul paradigme au creux duquel tout se joue.
Pour lui, l’unique dieu véritable était le temps.
Mais, voilà. A chaque nouveaux records, des parents signalent la disparition d’enfants. Et le vieil horloger de se voir alors projeté sur le devant de la scène, entre les espoirs que les parents fondent en lui et les suspicions mâtinées de séductions que le pouvoir (politique et policier) entretient tels de vieux réflexes.
Tour à tour roman de formation (d’un vieillard), énigme policière, fable politique, satyre positiviste, Les enfants disparaissent interroge d’abord notre rapport à l’enfance. Et qu’est ce que l’enfance, si ce n’est une interrogation sur le réel? Réel d’où, si les enfants disparaissent, c’est peut-être moins la conséquence d’un acte criminel que celle d’un acte porté sur le réel même. Où les adultes tombent dans le piège des mots qu’on assemble pour comprendre des choses, et dans celui du temps dont ils oublient qu’en son sein « tout est toujours pour toujours ». Un réel unique, figé, piège dans lequel seuls les enfants ne versent jamais.
Une table est une table, jusqu’à ce qu’un enfant s’asseye dessus : c’est alors une chaise…
Gabriel Banez, Les enfants disparaissent, 2010, La dernière goutte.