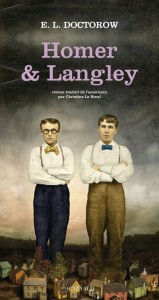On lit parfois un livre exhumé d’on ne sait où par un éditeur presque absent des librairies, et on se prend à imaginer les tours et détours tortueux que peuvent prendre les sentiers de l’édition. Comment se fait-il que ce roman soit resté obstinément ignoré du public français durant tant d’années? Cela demeure un mystère. Publié fin du dix-neuvième à Londres, il connut un rapide succès critique et public en Angleterre. Il servit de scénario à un film en 1924, à un autre en 1935. Sa première traduction française paraîtra pourtant seulement en 1944 et restera confidentielle. L’inexplicable du cas n’a de comparable que la surprise que sa lecture provoque.
Peter Ibbetson conte l’histoire d’un jeune anglais d’abord élevé à Paris, qui, à la mort de ses parents, s’exilera en Angleterre sous la protection de son oncle détesté. Oncle dont il s’émancipera peu à peu, découvrant l’amour au cours de circonstances étranges et l’adversité dans le drame. Le récit est classique, la langue de même. Mais peu à peu, dans un double mouvement, l’un de lent glissement, l’autre d’à-coups, le lecteur glisse vers le merveilleux.
Les personnages d’un roman eux-mêmes doivent agir conformément à la nature, à l’éducation, aux motifs que leur créateur, le romancier, leur a donnés, sinon nous mettons le roman de côté pour en prendre un autre : car la nature humaine doit être conséquente avec elle-même, dans la fiction aussi bien que dans la réalité ; même dans la folie, il faut une méthode : or donc, comment le Vouloir pourrait-il être libre?
Et la méthode est ici diablement efficace. Car le récit s’enchasse dans le fabuleux sans que jamais le lecteur ne s’inquiète de sa crédibilité. Sans doute parce que l’auteur a efficacement pu endormir notre sens du réel, ou plutôt le rendre perméable au sien ou à son idéal. Sans doute aussi car il nous donne à voir un fantasme à l’oeuvre qu’aucun lecteur n’aurait l’audace de ne pas reconnaître un peu sien : le « rêver-vrai ».
Le toucher d’une main disparue, le son d’une voix qui s’est tue, la tendre grâce d’un jour mort devraient être nôtre pour toujours, à notre merci, à notre appel, par quelque délicate et parfaite illusion des sens.
Et c’est cette prouesse que parvient à accomplir Peter Ibbetson. Mais cette illusion « délicate et parfaite » est-elle encore illusion? Si celle-ci ramène toujours l’être à l’essentiel ; l’amour, l’enfance, une odeur chère, ne peut-on y voir bien plus qu’un pis-aller? Si le réel, finalement, n’était qu’une question de choix?
boire, manger, dormir, aller et venir, travailler, comme auparavant ; mais tout cela, je le fis comme en un songe, car désormais, les rêves, les vrais rêves, étaient devenus, pour moi, la seule réalité.
Quelle réalité choisir? Bien loin de toute mièvrerie, par l’artifice d’une histoire qui ne peut que charmer, George du Maurier nous rappelle que notre réel est avant tout celui que l’on s’invente. Que toute réalité, si elle se veut aussi contrainte, jaillit d’abord d’un vouloir.
George du Maurier, Peter Ibbetson, 2005, L’or des fous.