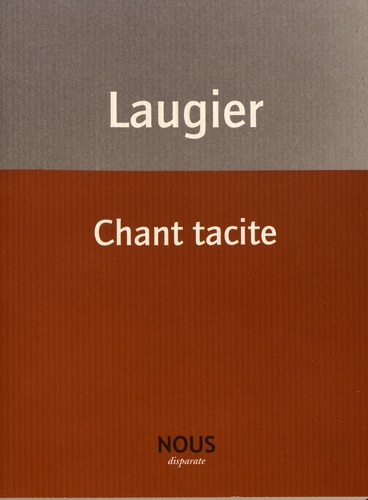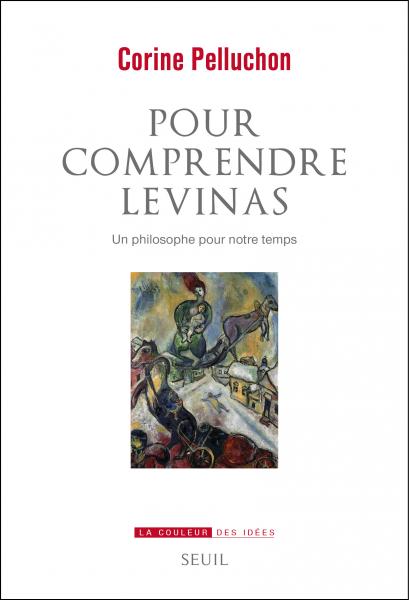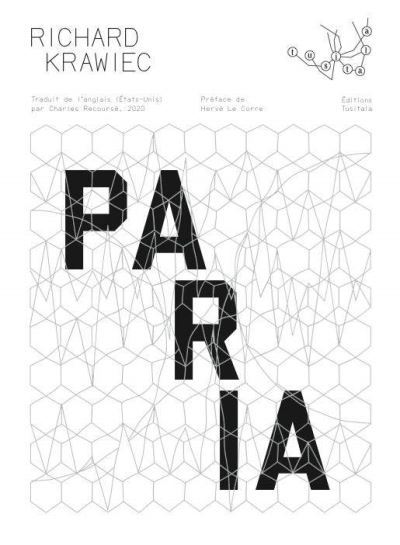Entre le 15 janvier et le 10 mars 1610, Galilée écrit et fait imprimer le Sidereus nuncius, qui paraît officiellement le 13 mars 1610, et dans lequel sont gravées, à partir de ses dessins, cinq eaux-fortes représentant la surface lunaire. Grâce à l’amas colossal de documentation disponible sur Galilée, on sait très bien qu’en sus des 550 exemplaires imprimés complètement, 30 exemplaires supplémentaires avaient été imprimés mais sans les gravures de la Lune. D’aucuns se demandaient dès lors si Galilée ne désirait pas y ajouter des dessins de sa propre main. Sur ces 30 exemplaires sans eaux-fortes, seuls 12 ont été conservés jusqu’à nos jours. Aucun d’entre eux ne comporte de dessin.
Mais à l’été 2005 un marchand de livres anciens italien vend à la prestigieuse librairie new-yorkaise Martayan Lan un exemplaire du Sidereus nuncius. Et dans celui-ci, chose exceptionnelle, figurent bien les fameux dessins attribués à Galilée, accompagnés de sa signature manuscrite sur la page de titre. Cet exemplaire hors-norme, dénommé SNML, fait alors l’objet d’une investigation technique et collective entre 2006 et 2011, investigation qui confirme bien l’authenticité du livre exceptionnel et donne lieu à la publication de deux ouvrages rédigés par les membres de l’équipe d’experts internationaux créée pour l’étudier. Mais en mai 2012, tout s’effondre! Grâce à l’opiniâtreté d’un spécialiste américain du livre ancien, il appert que le SNML est un faux…
Nous défendons la thèse que le SNML est un duel engagé avec la communauté des experts.
SNMM, anatomie d’une contrefaçon revient en détail sur la découverte de la supercherie. La confection de la signature manuscrite, la fabrication de la reliure, du papier, la contrefaçon de l’impression typographique, etc. toutes les étapes de fabrication d’un faux sont passées au peigne fin par les spécialistes. Se dévoilent alors au lecteur non seulement les mécanismes considérables mis en œuvre pour tromper les meilleurs « galiléistes » mondiaux, mais aussi ce qui sous-tendait cette tentative. Dans le temps même où l’on découvre les techniques de la supercherie, on aperçoit comme en vis-à-vis la démesure du faussaire et le dépit de ceux qui sont tombés dans le panneau. Et dans l’entre-deux, on décèle toute les fragilités à l’œuvre dans un débat intellectuel : celle de vouloir croire en l’incroyable comme celle de le produire. Et c’est passionnant…
Collectif, SNML, anatomie d’une contrefaçon, 2020, Zones Sensibles, trad. Christophe Lucchese et Arnaud Baignot